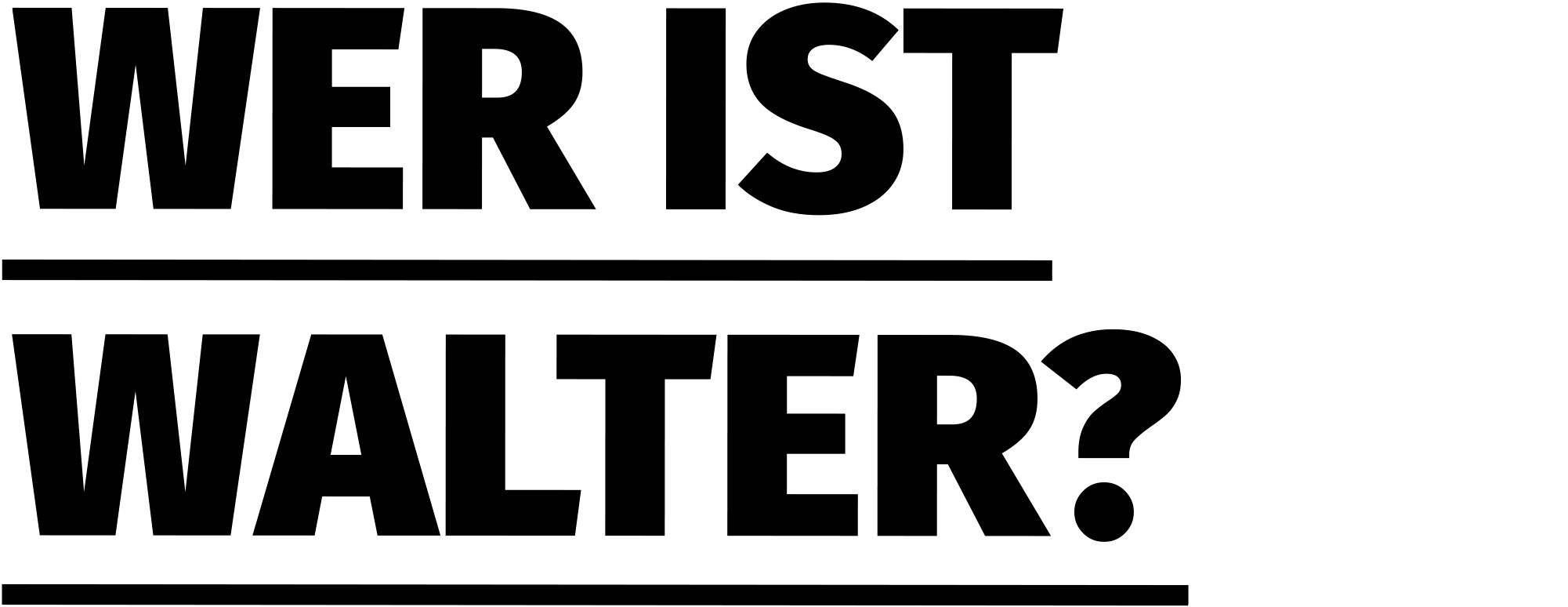Maquis et montagnes
Les paysages de montagne que nous apprécions tant et que nous contemplons à travers l’Europe sont souvent chargés de vestiges et de souvenirs des affrontements de la Seconde Guerre mondiale. Les régions montagneuses ont joué un rôle important dans l’histoire de la résistance en Europe. Ce fut par exemple le cas de la Yougoslavie occupée, où les montagnes devinrent un bastion des Partisans communistes à partir de 1941. “À travers forêts et montagnes” était d’ailleurs le titre d’une célèbre chanson des Partisans yougoslaves, et en 1944, Drvar (du mot “drva” signifiant “bois”), dans les montagnes occidentales de Bosnie-Herzégovine, était le quartier général de Joseph Broz Tito, que les Allemands ne réussirent pas à démanteler dans le cadre de l’opération Rösselsprung .
En France également, les montagnes ont joué un rôle important, comme lieux de refuge et de résistance. Les Pyrénées, à la frontière avec l’Espagne, ont été une voie d’évasion pour de nombreuses personnes persécutées par l’Allemagne nazie. Après l’introduction du Service du Travail Obligatoire par le régime de Vichy en 1943, les forêts et les montagnes sont devenues, pour de nombreux jeunes hommes, un lieu de refuge, et bientôt aussi un lieu propice à la création de groupes armés de résistance, les “maquis”. Le terme “ maquis”, littéralement un endroit avec une végétation dense, est devenu synonyme, pendant la guerre, de camps et de groupes de résistance armée cachés en dehors des zones urbaines. L’expérience du maquis est marquée par une vie ascétique et de longues périodes d’attente. Tous les maquisards ne sont pas issus de milieux ruraux : des ouvriers, des intellectuels et des artistes sont par exemple contraints d’apprendre à manier la hache et à couper du bois pour les besoins de la vie quotidienne.
Deux sites dans les Alpes sont devenus emblématiques de la Résistance française : le plateau des Glières et le massif du Vercors. D’importants maquis s’y sont constitués en 1943-1944, et ils sont devenus des éléments stratégiques de l’effort de guerre des Alliés contre l’Allemagne nazie. Mais ils furent finalement écrasés par les troupes allemandes et les forces françaises de collaboration en 1944. Malgré et à cause de ce destin tragique, les Glières et le Vercors sont devenus des symboles d’héroïsme et des éléments constitutifs du mythe même de la Résistance française. Le nom “Vercors” a également été choisi comme pseudonyme par l’écrivain Jean Bruller pour son roman “Le silence de la mer”, mais cela s’est passé avant que ce plateau montagneux ne devienne un lieu de résistance.
Les zones montagneuses ont également été d’importants espaces de refuge pour les Juifs et autres personnes persécutées, et de solidarité envers eux de la part d’une partie de la population locale, comme dans le village de Chambon-sur-Lignon dans la région du Massif central.
Yvan Gastaut